
Archives
départementales de l’Orne
8 avenue de
Basingstoke
61017
Alençon Cedex
Tél. :
02 33
81 23 00
Fax :
02 33 81
23 01
Mél :
archives@cg61.fr
Site :
archives.orne.fr
|
DEMANDEZ
LE PROGRAMME
| Expositions
|
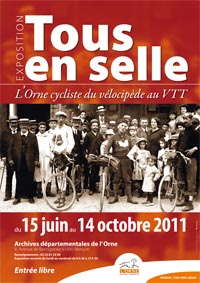
|
Du
15 juin au 14 octobre
2011
:
Tous en selle. L'Orne cycliste du vélocipède au VTT.
Les
Archives départementales de l’Orne proposent du 15 juin au 14
octobre
l’exposition Tous
en selle : l’Orne cycliste du
vélocipède au VTT.
S’appuyant
sur les richesses des Archives départementales et les collections
privées, l’exposition offre un regard sur les multiples usages du vélo
dans l’Orne depuis ses origines.
Depuis
les premiers vélocipèdes de la fin du XIXe
siècle jusqu’au VTT
d'aujourd’hui, les Ornais ont adopté le deux-roues pour le vélo et les
loisirs. Des clubs cyclistes sont nés, des courses ont été organisées
et des coureurs se sont illustrés.
Une
exposition avec des
partenaires
Organisée
par la Direction des
archives et des biens
culturels du Conseil général de l’Orne à l’occasion de Semaine fédérale
internationale du cyclotourisme qui se tient à Flers du 31 juillet au 7
août, l’exposition
Tous
en selle a constitué une occasion unique
d’associer les
acteurs les plus divers de la pratique du vélo : le Musée du
Vélo de La
Fresnaye-sur-Chédouet, les trois fédérations cyclistes (Fédération
française de
cyclisme, Fédération française de cyclotourisme, Fédération sportive et
gymnique du travail) et leurs clubs ornais, les actuels et anciens
coureurs
cyclistes, la section Sport-études
cyclisme de Flers, La Poste et un grande
nombre de collectionneurs privés.
|
Le
vélo dans tous ses états
Les
17 panneaux imprimés de
l’exposition retracent de façon très largement illustrée l’épopée du
vélo dans notre
département : l’apparition des premiers vélocipèdes,
l’évolution du vélo
et de l’équipement du cycliste, les marques de vélos et les nombreux
marchands
de cycles, les usages du vélo pour les déplacements quotidiens et les
promenades de loisir seul ou en groupe de cyclotouristes, le
développement
rapide des courses cyclistes sur route et sur piste, l’essor plus
tardif du
cyclo-cross puis du BMX et du VTT, la naissance de champions cyclistes,
le
foisonnement des clubs, l’avenir, avec les élèves du Sport-études de
Flers ou la course Paris‑Camembert,
et le passé, avec le
Musée du Vélo, véritable conservatoire de l’histoire du vélo en général
et du Tour de France en particulier.
Un
patrimoine cycliste riche et
varié
L’exposition Tous en
selle est une occasion inédite offerte au public
de
découvrir la
richesse des documents et des objets produits dans l’Orne par le vélo
et les
cyclistes. Des Archives départementales et de celles d’Alençon et Flers
a été
extraite une sélection de photographies, lettres officielles,
publicités,
journaux, etc. des années 1880 à aujourd’hui qui a trouvé d’heureux
compléments
empruntés à des collectionneurs privés. Vélocipède de 1892, vélos de
course de
toutes époques, tandem des premiers coureurs cyclistes ornais, vélos de
boulanger et de facteur illustrent concrètement les usages du vélo et
leur
évolution. Un échantillon de « produits dérivés » en
lien avec le
vélo et le cyclisme occupe également quelques vitrines.
L’Orne,
un département de
champions cyclistes
Depuis
les premières compétitions
des années 1880, les nombreuses courses organisées dans tout le
département ont
permis l’éclosion de champions cyclistes qui ont pu s’illustrer dans
les
courses départementales, régionales, nationales et internationales. Le
« Mur des champions », qui retrace le palmarès de 35
d’entre eux,
permet de les suivre en France mais également en Europe et sur d’autres
continents lors des grands championnats ou des Jeux Olympiques.
Plusieurs ont
accepté de prêter pour l’occasion leurs médailles ou maillots de
champions
remplis d’histoire et de passion. Quelques-uns ont même accepté de
raconter leurs
souvenirs de course et leurs témoignages filmés sont présentés dans
l’exposition.
Hall
des Archives départementales de l'Orne
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Fermé le vendredi 15 juillet (journée) et le mardi 6 septembre (matinée)
Entrée libre |
Du
1er juillet au 30 septembre 2011 :
L'œil et la main. Dix ans d'acquisitions.
Une
Vierge à l’Enfant tenant un cœur à la main, témoin de la naissance de
la
dévotion aux cœurs de Jésus et Marie popularisée par l’ornais saint
Jean Eudes
au XVIIe
siècle, un précieux reliquaire orné d’émaux et de camées à
l’antique
offert par Anne d’Autriche vers 1660 à une carmélite de Pontoise, des
canivets,
images pieuses découpées exécutées par des moniales au XVIIIe
siècle,
un calice
entièrement émaillé appartenant à un missionnaire en Chine au XIXe
siècle, des
chasubles richement brodées ou tissées, une table-jeu de l’oie des
années 1950
pour un apprentissage ludique du catéchisme … Les objets très variés
acquis par
le musée ces dix dernières années – achats, dépôts et dons –
permettent
d’évoquer les
conditions de leur
création d’un point de vue technique et de découvrir comment la main
des
artistes et artisans traduit concrètement aussi bien un concept
théologique
qu’une dévotion populaire.
Musée
départemental d'art religieux, place
du général de Gaulle (derrière la mairie), 61500 SéesOuvert tous les
jours sauf le mardi,
de 10 h à 18 h
Renseignements :
02 33 28 59 73
|

|
SOUS
LES PROJECTEURS
Publications
Jacques Jubert, Le Cidre, bibliographie
exhaustive.
Éditions de l'Émoi, 2010, 393 p., 54 €
Au cours de sa longue histoire, le
cidre a inspiré de nombreux auteurs qui ont étudié et décrit ses
fruits, sa fabrication, ses saveurs et ses bienfaits. Le Cidre, bibliographie
exhaustive révèle l'étendue de cette littérature peu
connue et développe les liens qui unissent l'homme au cidre :
l'agronomie, l'œnologie, l'économie, l'histoire et tant d'autres comme
la législation, l'art, la santé... Cette somme documentaire abondamment
illustrée s'adresse aux amis du bon cidre, aux praticiens - qui
cultivent ou transforment les fruits de pressoir -, aux chercheurs et à
tous les passionés de pomologie.
Jean-François Détrée, Musiciens et musique en
Normandie.
OREP éditions, 2010, 158 p., 29,90 €
La
vie terrestre n'est pas silencieuse. Le son, dans ses excès et ses
retraits, fait partie du quotidien des animaux et des hommes surtout
s'ils vivent en société. Du simple signal - par la voix, la corne ou la
cloche - jusqu'à la plus savante des compositions musicales, une gamme
d'expressions sonores s'est ainsi constituée et a évolué au gré du
besoin de musique formulé par les différents groupes sociaux (clergé,
paysans, artisans, seigneurs, notables, habitants des villes ou
ouvriers d'usine).
À
l'échelle d'une province, en l'occurrence la Normandie, l'analyse de
ces usages musicaux, abordée sans hiérarchie ni exclusive, constitue
une véritable histoire régionale de la musique. Non pas une histoire
régionaliste mais un tableau, riche ou lacunaire au hasard des sources
d'archives, de la pratique musicale des habitants de Normandie, depuis
la naissance de la province au Xe
siècle jusqu'au milieu du XXe
siècle.
De la louange divine à la complainte des rues en passant par la danse,
le concert, le défilé ou l'opéra, ce livre est à la fois une
découverte des usages et une synthèse des recherches historiques et
musicologiques faites sur l'histoire musicale des cinq départements
normands.
|
|
Salle
de lecture
Pour permettre le contrôle de
numérisation ou la numérisation, les documents suivants sont
indisponibles.
- les
cartes postales thématiques ;
- les registres
paroissiaux, d'état civil et les tables décennales dans lesquels des
oublis au microfilmage ont été constatés (cf. état des signalements et corrections
apportées) ;
-
une partie des
registres matricules (cf. suivi de numérisation de la série R) ;
- une partie des
tables des successions et absences de l'enregistrement (cf. suivi de numérisation de la sous-série 3Q).
|
Des images numériques sont désormais
accessibles en salle de lecture pour les documents suivants :
- les
registres matricules jusqu'à la classe 1910 (1911-1938 sur dérogation)
et les tables de recensement militaire jusqu'en 1938 ;
- la
première campagne de numérisation des tables de successions et absences
des bureaux de l'enregistrement du département (liste envoyée sur
demande) ;
- les
listes nominatives de recensement (an IX - 1968), cotées M 1436 à M
1582 et 520 W 1 à 520 W 64 ;
- la partie du
fonds Odolant Desnos selectionnée pour la numérisation (cf.
numérisation de la sous-série 31J).
|
EN COULISSE
La
production photographique des Archives départementales de l'Orne
On conserve
aux Archives départementales de l’Orne de nombreux fonds
photographiques d’origine privée : fonds de photographes
professionnels et fonds familiaux. Mais ce que l’on connaît moins,
c’est la production photographique des Archives elles-mêmes à travers
les clichés réalisés par ses membres, conservateurs, photographes ou
partenaires associés dans un projet éditorial.
C’est le cas de l’abbé Aubert qui
dans l’exercice de ses fonctions de conservateur des antiquités et
objets d’art a parcouru l’Orne à la recherche des édifices religieux et
de leur mobilier dans les années 1960/1970. Ses différents ouvrages et
brochures ne rendent compte d’imparfaitement de la richesse
iconographique qu’il a réunie et dont les Archives de l’Orne, sont les
détentrices. Les photos ci-jointes de la chapelle du cimetière
d’Ecouché ou les fonds baptismaux de Chênesec à Craménil témoignent de
son inventaire méticuleux et parfois surprenant !
Jean Gourhand, directeur des Archives de l’Orne, était un infatigable
promeneur qui s’est attaché à
fixer sur la pellicule tous les lieux singuliers ou en cours de
changement, les manifestations de toutes sortes, non sans humour et
poésie. En témoignent une série de photos de l’ancien grenier à sel
d’Alençon, détruit dans les années 70 pour faire place … à un
parking ! Un autre cliché nous montre sa « promenade
archéologique » en compagnie de Mademoiselle Mercier dans les
ruines mises au jour lors du réaménagement des bords de
Sarthe, toujours à Alençon. Son travail s’étend, là encore, sur la
totalité du département.
|

  
|
De
nombreux autres acteurs ont
contribué à enrichir cette collection photographique, constituée de
clichés et de tirages, réalisés principalement entre 1950 et 1980 et
dont le nombre avoisine 10 000 documents.
L’intérêt d’une telle collection
est d’une part son exhaustivité (aucun village de l’Orne n’est oublié),
d’autre part la datation souvent précise des clichés qui montre un état
à un moment donné d’un patrimoine souvent transformé, parfois détruit
depuis lors. On ajoutera enfin que dans la majeure partie des cas, les
photos sont d’une très bonne qualité.
Cette collection qui fut un temps
consultable par le public sous forme de tirages rassemblés dans des
albums, est en cours de traitement : tri, description et
indexation dans la base Gaia,
précèdent une grande campagne de numérisation qui mettra à portée des
lecteurs des images numériques plus facilement visibles. |
INSCRIT
AU RÉPERTOIRE
Achat de photographies de la
Ferté-Macé
La Direction des archives et des biens
culturels de l'Orne a
récemment acquis des photographies de La Ferté-Macé. Les huit
premiers tirages on été pris par M. Bonnesœur, photographe à Flers, le
11 septembre 1887 alors que M. Barbe, ministre de
l'Agriculture,
inaugurait le comice agricole de l'arrondissement de Domfront. Pour
l'occasion, MM. Bouteiller et Challemel avaient reproduit, en guise de
porte d'entrée, celle du château de Carrouges alors que le docteur
Legallois s'était quant à lui chargé de deux tours médiévales. Onze
autres photographies illustrent la bénédiction des cloches et clochers
de La Ferté-Macé, le 30 juillet 1899, par Monseigneur Bardel, évêque de
Sées.
|

   |
Versements d'archives contemporaines
1701 W
: centres des impôts fonciers.
Tables de correspondance ancien cadastre / cadastre rénové (1930-1974).
1702 W : Association des
maires de
l'Orne.
Assemblées
générales, livres de comptabilité générale, index des maires de l'Orne
(1975-2000).
|
LEVER
DE RIDEAU
|
Le
Paris-Brest-Paris à Mortagne-au-Perche
De
la photographie qui illustre l'affiche de l'exposition Tous en selle,
présentée du 15 juin au 14 octobre aux Archives départementales, nous
ne connaissions à l'origine que sa provenance : elle est issue
d'archives familiales de la région du Mêle-sur-Sarthe. Voici quelques
explications sur le travail d'identification mené par les Archives
départementales.
|
 |
|
Sur cette
photographie, une affiche figure en arrière plan. On peut y lire : 3e co /
Paris
- / organisée
par
... Pe.
Il s'agit en fait de la 3e course
Paris
- Brest - Paris organisée par
le Petit
Journal
(avec le
concours de l’Auto-Vélo), donc
celui de 1911 (des photographies du Tour
de France de la même époque montrent que les freins de type
« Bowden » existaient déjà).
La
liste des
inscrits, publiée dans le Petit
Journal du 26 août 1911 (disponible ici
: http://gallica.bnf.fr), mentionne un touriste routier
portant le numéro 212 : Anasthase Nicolopoulo (coureur de
droite, numéro sur la sacoche).
Le Paris -
Brest - Paris de 1911 passe au Mêle-sur-Sarthe, mais le point de
contrôle est à Mortagne-au-Perche, place d’Armes, au café de L’Ancre,
tenu par Placide Gautret. Retrouvé sur une carte postale (postée en
1911), la devanture du café correspond exactement à celle de la
photographie.
Le
Perche
relate la course dans ses éditions du 27 août et du 3
septembre :
27/08 :
« A noter que parmi ceux-ci se trouve un vieillard de 65 ans,
le père Ratier, qui est arrivé à minuit 16, très dispos et ne
paraissant même nullement fatigué. Les contrôleurs et les consommateurs
se trouvant au café de L’Ancre lui ont fait une chaude ovation. En
prenant un bol de bouillon, le père Ratier a alors raconté qu’il avait
déjà pris part aux deux premières courses décennales Paris - Brest et
qu’il espérait
bien encore courir la prochaine course qui aura lieu en 1921 ;
il est, après cela, reparti en disant qu’il se proposait de se rendre à
Rennes d’une seule traite ».
03/09 :
« N’oublions pas non plus de mentionner que le père Ratier, ce
vaillant coureur de 65 ans, dont nous avions dans notre dernier numéro
signalé le passage à l’aller dans la nuit de vendredi à samedi, a été
de retour au contrôle de Mortagne dans l’après-midi de
mercredi ; il a été l’objet d’une chaude ovation de la part
des habitants de la place d’Armes, et un gentil bambin, le petit
Deshayes, lui a offert un bouquet. Trés touché par cette manifestation
de sympathie, le père Ratier, qui avait aussi bonne mine et paraissait
aussi dispos qu’à l’aller, a dit qu’il serait très heureux de pouvoir
présenter ce bouquet à L’Auto,
puis, après l’avoir fixé sur sa bécane il est reparti dans la direction
de Paris, où il espérait arriver dans la nuit. »
À Paris, Pierre
Ratié arrive en soixantième position après 142h de course. Derrière lui
deux hommes : Léon Delocre et Anasthase Nicolopoulo en 144h15.
Voici
donc l'analyse complète de cette photographie : 3e
course Paris - Brest - Paris organisée par le Petit Journal (avec
le
concours de l’Auto-Vélo).
Mortagne-au-Perche, place d’Armes, point de
contrôle du café de L’Ancre. 30 août 1911.
Le permier
touriste routier (sur la gauche) est Léon Delocre (qui donnera son nom
à une randonnée organisée par le CV Béthune). Le deuxième
touriste routier est Pierre Ratié (né à Moissac, dans le
Tarn-et-Garone, le 6 juin 1846). L’enfant est
Robert Deshayes, né à Mortagne en 1908, il est le fils du quincailler
de la place d’Armes. Il est décédé aux Andelys en 1989. Quant
au troisième touriste routier (sur la droite), il s'agit effectivement
d'Anasthase Nicolopoulo !
|
SOUFFLEUR
La
verrerie du Gast à Tanville
La
fabrication de la verrerie est
attestée dans l’Orne depuis la fin du Moyen Age.
Artisanat puis industrie, on la trouve toujours installée à proximité
des massifs forestiers : forêts d’Andaine, d’Écouves, du Pays
d’Ouche,
de la Trappe, etc. On considère que sur une
période d’environ sept siècles, une bonne vingtaine d’ateliers ont
existé sur le sol ornais, certains ayant eu une existence éphémère.
Afin de
faire mieux connaître ce patrimoine, d’approfondir la connaissance des
verreries, de leur personnel et de leurs productions, les Archives
départementales forment le projet de réaliser une exposition
sur la verrerie dans l’Orne au cours de l’été 2012.
Les traces de cette activité sont
très nombreuses dans les archives, autant celles des grandes familles
normandes qui ont dirigé les établissements que celles des innombrables
ouvriers qui ont exécuté des objets de toutes natures,
de l’humble bouteille à vin jusqu’aux verres décorés à la manière de
Venise ou de Bohème. Quiconque parcourt les archives a probablement
déjà croisé un verrier ou de la verrerie dans ses sources. Nous sommes
donc intéressés par toute contribution que les utilisateurs d’archives
ornaises pourraient nous apporter à la fois sur le personnel et sur les
établissements. Et notamment si vous avez pu assister à l'exposition
présentée ci dessous, organisée par l''abbé Renard, curé de Belfonds,
en août 1967.
|

    |
SOUS
LES PLANCHES
Un démonte pneu devant servir à
retirer de leurs jantes les enveloppes
des bicyclettes
Parmi
les dessins et modèles
déposés au
tribunal de commerce de L'Aigle entre 1874 et 1939, voici le
contenu d'une boîte de bois scellée qui vient illustrer l'ingéniosité
d'un habitant de Saint-Symphorien-des-Bruyères en matière de
vélocipédie. Célectin, Léopold, Marcel Saussay est né à L'Aigle le 10
février 1886 ; il est le fils d'un ancien huissier. D'abord tourneur
sur
bois, il devient mécanicien d'où l'invention de ce démonte
pneu devant servir à
retirer de leurs jantes les enveloppes
des bicyclettes... Après la première guerre mondiale, il
quitte la région pour rejoindre la capitale.
|
ACTEURS
DE LA RECHERCHE
|
Ruth-Ellen St. Onge : un peu de
poésie !
Après avoir suivi
une formation de bibliothécaire, complétée par une maîtrise en sciences
de l'information, Ruth-Ellen St. Onge est désormais doctorante au
département d'études françaises de l'Université de Toronto (Canada). Sa
thèse porte sur le recueil poétique entre 1830 et 1875 : étude
biographique, historique et sociologique. Durant une semaine,
Ruth-Ellen St. Onge est venue consulter les collections des Archives
départementales de l'Orne et notamment la sous-série 3J, les papiers
Poulet-Malasis (1842-1891), l'imprimeur des Fleurs du Mal
de Charles Baudelaire. Des archives particulièrement intéressantes pour
juger des rapports entre éditeurs et poètes mais
aussi pour
apprécier le recueil poétique en tant qu'objet matériel.
|

|
|
|
|